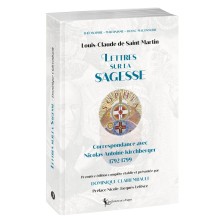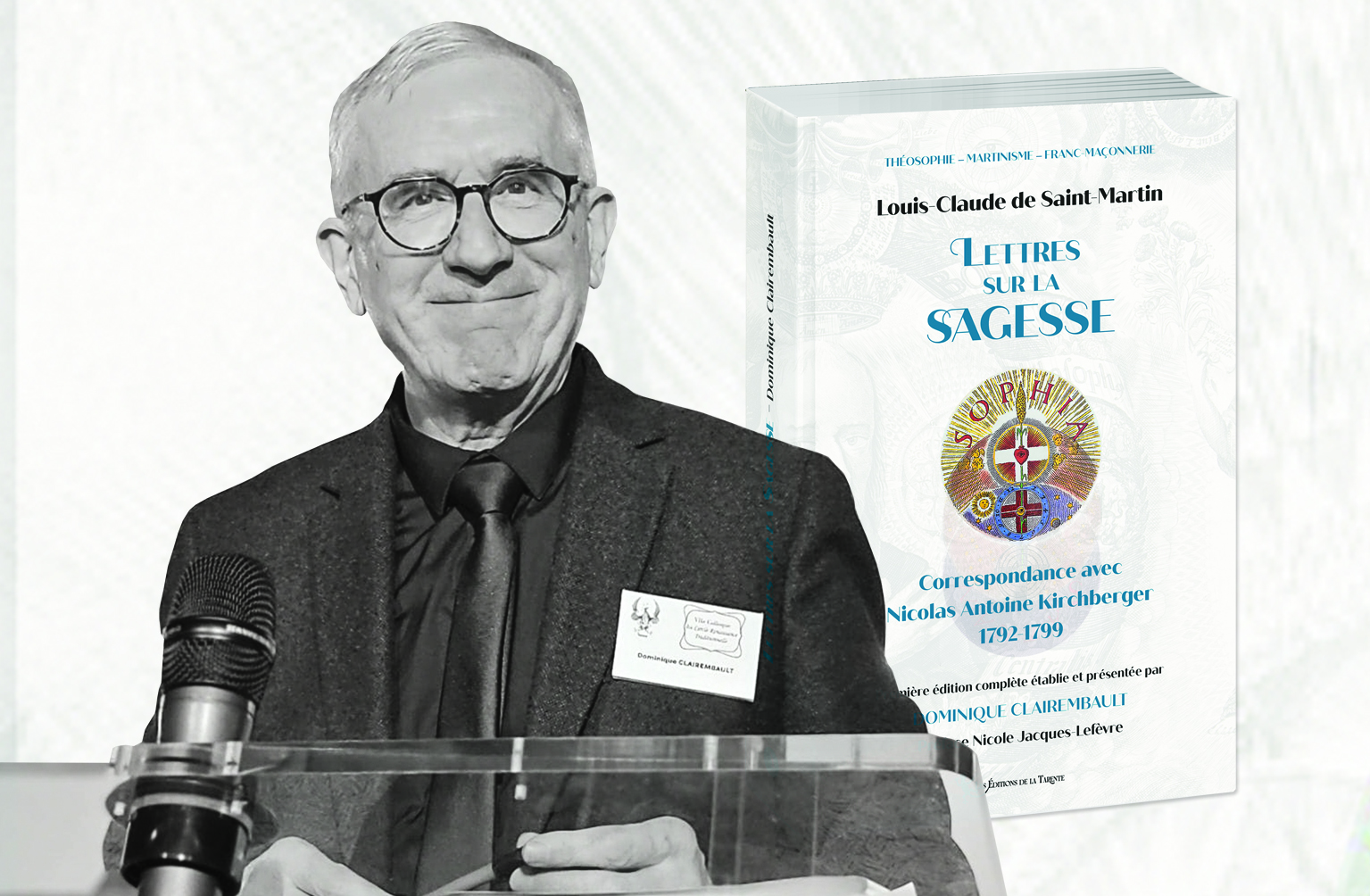
3 questions à Dominique Clairembault
Attendue depuis longtemps, la correspondance entre Louis-Claude de Saint-Martin et Nicolas Kirchberger (1792 à 1799, 146 lettres) a enfin été restituée récemment, un important travail que l’on doit à Dominique Clairembault dans un ouvrage publié aux Éditions de La Tarente et intitulé Louis-Claude de Saint-Martin, lettres sur la Sagesse. Historien de l'illuminisme et du martinisme (du XVIIIe siècle à nos jours), secrétaire de la Société d’étude de Louis-Claude de Saint-Martin et rédacteur en chef des « Nouveaux Cahiers de Saint-Martin » (Renaissance Traditionnelle), Dominique s’est confié à notre équipe.
La Tarente : Cher Dominique, merci de nous avoir confié l'édition de ce livre. Important à plus d'un titre, à qui s'adresse-t-il ?
Il s’adresse aux lecteurs des œuvres de Louis-Claude de Saint-Martin mais aussi à ceux qui s’intéressent à l’illuminisme, c’est-à-dire à l’ésotérisme du XVIIIe. Il touchera donc spécialement ceux qui s’intéressent au martinisme ou à la franc-maçonnerie. Plus largement, il s’adresse à tous ceux qui sont en quête de Sagesse.
Cette publication me semble fondamentale pour comprendre la pensée de Louis-Claude de Saint-Martin. En effet, entre son premier ouvrage, Des Erreurs et de la vérité, publié en 1775 et Le Ministères de l’homme-esprit, publié en 1802, soit un an avant sa mort, sa façon d’envisager le processus de l’initiation, le cheminement vers la Sagesse, avait beaucoup évolué. Comme le montre cette publication, ce n’est qu’à la fin de sa vie que sa pensée atteint sa pleine maturité. Cette correspondance entre Saint-Martin et Kirchberger est donc particulièrement utile pour comprendre la pensée du Philosophe inconnu dans la mesure où elle témoigne de l’aboutissement de son cheminement.
Dans ses lettres Saint-Martin répond aux questions de Kirchberger qui l’interroge sur le sens des passages les plus mystérieux de ses deux premiers ouvrages. Très intéressé par ce qui concerne les manifestations spirituelles, la théurgie, Kirchberger souhaite que Saint-Martin lui prodigue ses conseils. Cependant, le théosophe a délaissé ces pratiques au profit d’un cheminement intériorisé, marqué par les idées de Jacob Boehme. Les réponses de Saint-Martin nous permettent de comprendre ce qu’il en est de ce cheminement. Comme il l’écrira lui-même il veut « conduire l'esprit de l'homme par une voie naturelle aux choses surnaturelles qui lui appartiennent de droit, mais dont il a perdu totalement l'idée, soit par sa dégradation, soit par l'instruction fausse de ses instituteurs. » (Mon portrait, 1135.)
Ce qui est intéressant pour le lecteur, c’est que les sujets abordés par les deux épistoliers permettent aussi au lecteur de découvrir les différents courants qui marquent l’illumisme. Il y trouvera par exemple une description des faits étonnants qui se produisirent lors de l’inauguration de la loge de Cagliostro à Lyon, des détails sur les expériences mystiques de Johann Gorges Gichtel avec la Sophia, où celles d’autres personnalités. Leurs échanges nous apportent non seulement des informations passionnantes sur les milieux initiatiques de la fin du XVIIIe siècle mais également sur les auteurs et les ouvrages importants de la théosophie. C’est donc tout un monde qui s’offre à la découverte du lecteur de ces Lettres sur la sagesse, un monde qui dépasse l’horizon de l’ésotérisme. D’ailleurs la théosophie du Philosophe inconnu a laissé une marque discrète dans la culture européenne et a contribué à l’éclosion du romantisme, comme l’ont montré Auguste Viatte et Ernst Benz (Les Sources occultes du romantisme, 1928 ; Les Sources mystiques de la philosophie romantique Allemande, 1968).
La Tarente : Ce récolement n'est pas une nouveauté. Jusqu'à ce jour incomplet et fautif, peut-on dire qu'il est maintenant définitif?
Il faut souligner que notre édition va bien au-delà de celle, très fragmentaire, publiée par Louis Schauer et Alphonse Chuquet en 1862. Plus complète, elle propose 155 lettres, alors que la première n’en proposait que 114, souvent incomplètes et entachées d’erreurs de transcription. Notre édition se base sur plusieurs sources manuscrites qui permettent de restituer l’intégralité de la correspondance avec toutes ses composantes. Elle comporte en effet les extraits des ouvrages citées par Saint-Martin et Kirchberger, avec leurs traductions lorsqu’il s’agit de textes en anglais ou en allemand. Elle propose aussi un appareil critique qui permet d’éclairer le lecteur sur les personnes, les événements ou les textes cités dans les lettres. Enfin, un index très complet permet aux lecteurs de revenir facilement sur les thèmes évoquées par les deux correspondants. Cette nouvelle édition propose donc un véritable outil pour aborder la pensée du Philosophe inconnu.
S’agit-il pour autant d’une édition définitive ? Une édition n’est jamais définitive, car de nouvelles découvertes pourraient l’enrichir. Elle pourrait aussi être complétée par les échanges de Kirchberger avec le comte de Divonne, l’un des amis de Saint-Martin, qui s’inscrivent dans la même époque. Nous avons été tentés de les insérer dans ce livre, mais pour ne pas alourdir cet ouvrage déjà volumineux, nous avons préféré les garder pour une publication ultérieure.
La Tarente : Kirchberger n'a quasiment pas laissé d'ouvrage, si ce n'est une importante correspondance avec un grand nombre d’« illuminés », alors qu'est-ce qui fait la particularité de ce personnage ?
En effet, son étude sur le gypse, « Versuche über den Gyps » publiée à Berne en 1771 (et en traduction française dans le Journal de l’abbé Rozier en 1774) est le seul texte qu’il a publié. Il concerne ses expériences sur les sciences naturelles. Il a laissé par contre une correspondance importante, notamment avec Lavater, Eckartshausen et Saint-Martin. Celles qui concernent ce dernier sont particulièrement intéressantes, car les réponses du Philosophe inconnu aux interrogations de Kirchberger obligent le théosophe à préciser sa doctrine. En fait, Saint-Martin répond à des questions que se posent tous ses lecteurs. Paradoxalement, ce dialogue avec Kirchberger permet à Saint-Martin de parfaire sa doctrine à un moment où il cherche à marier les idées de Martinès de Pasqually avec celles de Jacob Boehme.
Par sa connaissance de la langue allemande, Kirchberger va d’ailleurs aider Saint-Martin à traduire les œuvres de Boehme en français. Kirchberger joue donc un rôle important dans la vie du Philosophe inconnu. Il est d’ailleurs l’homme avec lequel Saint-Martin eut le plus d’affinité.
La Tarente : Ton cheminement est peu connu : auteur de nombreux articles dans de fort belles revues, éditeur du site www.philosophe-inconnu.com, ton "amour" du Philosophe Inconnu semble t'être chevillé au corps. Quel est le chemin qui t'a amené jusqu'à lui ?
Pour ce qui est de mon intérêt personnel pour les écrits de Saint-Martin, il tient au fait qu’il s’agit d’un personnage fondamental de l’ésotérisme occidental. Ses livres, considérés dès le XVIIIe siècle comme des classiques dans leur genre, ont connu un rayonnement important en Europe.
J’ai découvert son œuvre il y a plus de quarante ans, à la fin des années 1970, en fréquentant les milieux « martinistes ». C’est à cette époque que j’ai lu Des Erreurs et de la vérité, premier ouvrage de Saint-Martin. Ce n’est que quelques années plus tard que j’ai commencé à comprendre le sens réel de cet ouvrage énigmatique et des autres livres du même auteur, comme L’Homme de désir ou Le Ministère de l’homme-esprit. Les travaux de Robert Amadou, d’Antoine Faivre et de Nicole Jacques-Lefèvre m’ont servi de guide. Mes relations personnelles avec Robert Amadou et plus encore avec Antoine Faivre m’ont apportées des clefs essentielles pour comprendre la théosophie de Louis-Claude de Saint-Martin et le milieu assez complexe de l’ésotérisme du XVIIIe siècle, l’illuminisme. Avec Saint-Martin, nous sommes au cœur de l’âge d’or de l’illuminisme. Ce courant de pensée s’inscrit dans la théosophie, un mouvement qui débute au XVIIe siècle avec Jacob Boehme et se termine avec Franz von Baader au milieu du XIXe siècle. Saint-Martin fut un acteur essentiel de ce milieu et mon intérêt ne s’arrête pas à ce personnage mais à tout ce courant de pensée.
Depuis la fin du XIXe siècle, la théosophie de Saint-Martin est trop souvent réduite à un occultisme qui est assez éloigné de sa pensée. Celui qu’on appelle « le Balzac de l’occultisme », Papus, est en partie responsable de cette situation. Déjà, en 1928, René Le Forestier écrivait : « Le Dr Encausse, qui, sous le nom de Papus, tenta de ressusciter l'ancienne société en l’appelant : Ordre Martiniste, ne semble pas avoir très bien compris ce qu’étaient et ce que recherchaient ceux dont il se prétendait le successeur ; il n’a pas non plus jugé nécessaire d’étudier, même superficiellement, l’histoire de la Franc-maçonnerie et celle de l’occultisme, sur lesquelles il débite avec une imperturbable assurance les bourdes les plus monumentales. » (La Franc-Maçonnerie occultiste au XVIIIe siècle et l’Ordre des élus coëns, Dorbon-Ainé, 1928, p. 11-12.)
L’association des Amis de Saint-Martin, avec Robert Amadou, puis Antoine Faivre, Nicole Jacques-Lefèvre et quelques chercheurs, ont contribué à présenter un autre visage du Philosophe inconnu. En 2003, j’ai eu l’idée de reprendre cette approche en créant un site internet proposant des documents et des études sur Louis-Claude de Saint-Martin et le martinisme du XVIIIe siècle. C’est ainsi qu’est né, en octobre 2003, au moment où l’on fêtait le bicentenaire de la mort de Louis-Claude de Saint-Martin, le site philosophe-inconnu.com. Ce site existe depuis plus de vingt-ans. Il propose des études sur Saint-Martin. Il s’intéresse aussi aux différents courants de l’illuminisme et propose des recensions d’ouvrages en relation avec ces sujets. Accessoirement, il propose quelques articles en relation avec le néo-martinisme moderne.
Pour revenir à l’ouvrage qui fait l’objet de cet entretien, la Correspondance, il résulte d’un projet initié en juillet 2005, à la suite de discussions avec Antoine Faivre. Rappelons qu’il est lui-même auteur d’un ouvrage consacré à Kirchberger publié en 1966, (Kirchberger et l’illuminisme du dix-huitième siècle). C’est lui qui m’a poussé à présenter mes recherches sur cette Correspondance dans le cadre de l’École Pratique des Hautes Études (EPHE, section Sciences religieuses : Histoire des courants ésotériques dans l’Europe moderne et contemporaine). L’ouvrage que je présente ici, Lettres sur la sagesse, est une version abrégée de l’étude que j’ai présentée à l’EPHE en 2018, sous la direction de Jean-Pierre Brach (jury : Pierre-Yves Beaurepaire, Claude Rétat, Antoine Faivre).